Du kombucha à Kessel, une ribambelle de miracles


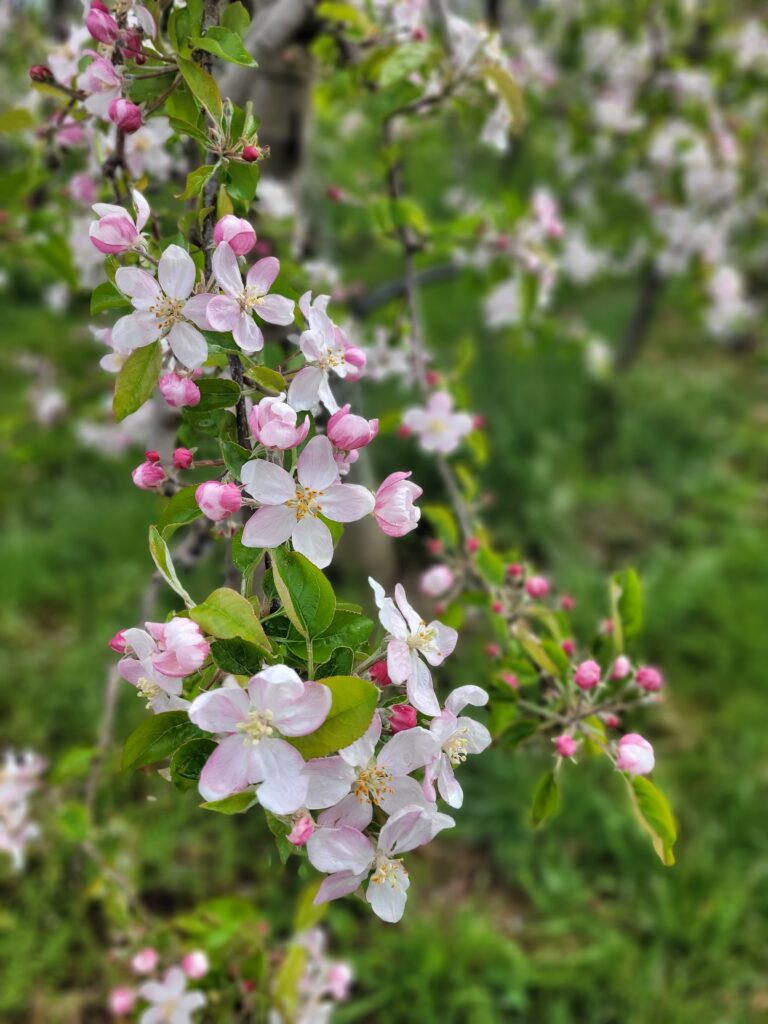
C’est quoi dans le bocal ?
Ma fille m’interpelle depuis la cuisine où elle range son petit déjeuner. Je me suis installée sur le canapé, mon ordinateur sur la table basse.
– Dans le bocal ? De l’eau.
J’ai rempli un bocal à fermentation d’eau bouillante pour le nettoyer.
-Non, là, c’est pas de l’eau, c’est dégueulasse…
-Ah, l’autre bocal, des mamas kombuchas.
-Ça me dégoûte un peu.
-Ne regarde pas, je suis en cours de remise à zéro de mes petites affaires fermentées.

Lors de mon passage à Avignon chez ma cousine en septembre (voir l’article La Vierge Marie prend la carte bleue), elle m’avait confié un bocal dans lequel flottait une méduse grise et opaque entre deux eaux d’un liquide brun. La consigne était d’ouvrir le bocal en arrivant et de la garder à l’ombre. Mon bocal mystérieux avait pris le train calé dans mon sac à dos, que je veillais à garder vertical pour éviter un dégât des eaux à l’odeur de vinaigre sucré. La recette pour l’utiliser semblait simple : préparer du thé noir fort avec de l’eau déchlorée, ajouter du sucre, le champignon visqueux et un peu de son liquide, et placer la préparation dans le noir. Après une semaine de fermentation, la masse vivante indéfinie de la levure géante gavée et reproduite, le liquide, légèrement pétillant, sera prêt à consommer. La magie naturelle de ce soda maison délicat et très peu sucré m’avait appâtée. J’étais donc repartie pour Lyon avec une mama kombucha planquée dans le sac à dos. Au Moyen Âge, une femme aurait été envoyée au bûcher pour moins que ça.

Bien sûr, j’ai abordé le kombucha comme toute autre préparation culinaire, avec enthousiasme, improvisation et approximations. Faute de disposer d’un bocal au diamètre adapté pour stocker les filles produites à chaque fermentation, je les laissais toutes ensemble. Ma boisson, devenue très acide, donnait l’impression d’avaler du vinaigre sucré et légèrement parfumé. Un passage à Avignon pour Pâques m’a permis de regoûter le parfum attendu de la boisson fermentée — peu acide — et de photographier la recette à nouveau. L’achat d’un bocal au bon diamètre me permettra de stocker les mamas dans leur hôtel (oui, c’est le nom) et d’éviter que ma boisson hebdomadaire soit suractivée par une famille nombreuse. Donc ce matin, j’ai sorti toutes mes méduses sur une assiette et, armée de deux fourchettes pour les préserver des bactéries, j’ai décomposé leur arbre généalogique avant de les ranger dans le bocal bas. Celui qui est dégueulasse.

Avec des grains donnés par une amie, des rondelles de citron, du sucre, et une figue sèche indicateur de fermentation, je prépare aussi du kéfir à l’eau. Lorsque les bulles poussent la figue vers la surface, au bout d’un jour ou deux, c’est prêt. Le goût frais rappelle celui des yaourts au citron de son enfance, me dit mon mari. Je suis devenue une adepte de l’alchimie de l’ombre de la fermentation volontaire. Même vinaigrée et sous une forme hybride mystérieuse entre champignon noir réhydraté et bactérie géante croisée avec un nénuphar, la fidélité des prodiges minuscules polit le quotidien.
Parfois, un miracle plus rare éclate sous nos pieds.
Un mardi de février en début de soirée, en sortant de la répétition de musique de chambre, j’ai trouvé sur le trottoir devant la mairie, dans le halo de l’éclairage de l’arrêt de bus, un portefeuille noir. Ça sent la chute de la poche au moment de la descente du bus. Même si de nos jours cette association est taboue, son tissu irisé en fait, statistiquement, un objet plutôt féminin. J’imagine la femme dans la cohue de la descente du bus en heure de pointe, se hâter de retrouver son chez elle et qui, la porte à peine refermée, glisse une main dans sa poche, une autre et a beau fouiller, refouiller, retourner la veste et renverser le sac à main, ne trouve rien. Une fois, deux fois, elle recommence les étapes, puis le déni cède à la détresse : « Me*de mes papiers, ma carte bleue… »
Me*de alors ! Comment vais-je retrouver la propriétaire ? Ma première réaction, peu glorieuse, invoque plus de gros mots. Le portefeuille d’une autre, c’est du souci dont je me passerais volontiers. Ce soir de février, je monte vers la mairie pour vérifier que l’accueil est bien fermé. Bien sûr que c’est fermé. Ce manège semi-conscient s’adresse à un éventuel observateur qui pourrait soupçonner la main qui ramasse un portefeuille de vouloir en garder le contenu pour elle s’il est trop vite glissé dans un sac. Cette responsabilité m’encombre : comment vais-je le restituer à temps, avant l’opposition et les démarches administratives ? Lasse, je remets la décision au lendemain où je me force à ouvrir le portefeuille, intimidée par l’impression d’entrer par effraction dans la chambre d’une inconnue.
La carte d’identité me confie le nom d’une jeune femme, qui m’envoie sur un compte Facebook, lequel me refuse d’envoyer un message sans être équipé de Messenger, et LinkedIn exige que je passe à la caisse avant de pouvoir la contacter. Son dernier lieu de travail semble être une boutique d’alimentation dont le numéro est public. J’appelle, une voix féminine m’informe que la dame ne travaille plus chez eux, mais se propose de la prévenir. Quelques minutes après, une jeune femme m’appelle :
-Vous avez mon portefeuille ?
-Oui.
-Oh je suis trop heureuse ! J’étais justement sur le site de la mairie pour tout refaire. Si vous voyiez ma tête, j’arrête pas de pleurer, j’ai le nez rouge. J’enchaîne les galères. Mon appartement a brûlé fin décembre, je vis chez ma mère avec mes enfants, l’assurance n’a encore rien payé… Si vous savez comme je suis soulagée ! Qu’est-ce que je peux faire pour vous ?
Rien, rien, votre réaction est déjà un cadeau.
On se donne rendez-vous à un arrêt de bus, un autre, en fin de matinée. Sur ce trottoir désert, en lieu de mot de passe, elle m’appelle dès qu’elle m’aperçoit. Je lui remets son portefeuille noir irisé, vierge de toute intrusion au-delà de la carte d’identité. Elle me tend un sachet de papier blanc fermé par un ruban vert, d’où dépasse un sachet de meringues roses et blanches.
-Tenez, pour vous remercier.
Un petit miracle, sur le côté de la route ébloui de soleil, près d’un arrêt de bus, que je me hâte d’épingler à la page avec des mots. Avec ma collection de prodiges minuscules, je bâtis des gués pour traverser les jours gris sans trop me faire éclabousser.

Le jour de l’adieu à Sophie, l’intensité de la séparation en avait attrapé toute une ribambelle, de musique, de lumière, de révélations, et d’humour.
Un chant d’orgue, Le Cygne de Saint-Saëns, a accompagné notre arrivée à l’église, le Largo de Haendel, notre sortie, guillemets de musiques que j’ai jouées au piano avec un violoncelliste et une amie violoniste, et que j’aime beaucoup. En entrant, sur un panneau d’annonces de cette église anglaise, mon regard brouillé s’est posé sur un dépliant au sujet d’une sainte Elisabeth Prout, cocasserie accessible aux seuls francophones. Sourire intérieur, à l’extérieur, épisode cévenol. Sophie, l’espiègle, je te reconnais bien là. Tu nous fais un autre clin d’œil lorsque le prêtre évoque la lumière au bout de la souffrance, dansante, dérisoire, vulnérable, mais présente comme la flamme du cierge devant lui. Juste à cet instant, une lumière réchauffe mon épaule droite, un rayon de soleil entre par le vitrail.
Derek l’organiste, un ami de Sophie de 80 ans, lit le texte qu’il a écrit pour elle, magnifique, émouvant. Lui et sa femme ont accueilli Sophie lors de sa conversion de l’Église anglicane vers la catholique, de l’autre côté de la ruelle, ils ont un fils handicapé. Il lit un passage sur Sophie qui pilote l’avion, qui imagine le monde en dessous, car comme chacun sait « les images sont meilleures à la radio qu’à la télé ». Il interroge la vie de ceux qui souffrent, en empruntant une première personne du pluriel. Pourquoi souffrons-nous ? Nous souffrons pour vous donner l’occasion de faire un geste gentil à notre égard, et vous sentir mieux avec vous-mêmes. Nous souffrons, comme le Christ sacrifié dans les évangiles, pour que vous appréciiez mieux les petites choses de la vie si précieuses.
À la sortie, dans cette ruelle étroite, préoccupée par le mystère trop grand de cette vie dans une boîte, je comprends soudain que ce qui me fait tenir debout à cet instant, c’est ma guirlande de petits miracles : le rayon de soleil chaud sur l’épaule, les premiers crocus dans l’herbe, les narcisses nains sur le trottoir, les mélodies à l’orgue, l’humour de Sophie. Tu m’avais raconté, mis amusée mi agacée, que pour réserver un voyage, il t’avait fallu choisir ton handicap : physique ou visuel, le formulaire ne permettait pas de cocher les deux. Bienheureux concepteurs…
Pourquoi avons-nous ce besoin de regarder plus bas pour nous consoler ?
Non, taisez-vous les rabat-joie, ne me rappelez pas que les tours de magie du quotidien, éphémères et insignifiants à notre image, résultent du déterminisme de la biologie ou de l’astronomie, de la chimie du libre-arbitre ou du hasard.

Parfois les tourbillons de la vie déposent sur un canapé entre bouquins et films, pour que le Covid, qui s’est invité dans mon corps mi-mars sans payer de loyer, se mette enfin en quête du chemin de la sortie.

Mes dernières découvertes artistiques portent, coïncidence ou magie, sur l’immigration et le mélange des cultures. Ahmed Kalouaz, arrivé bébé d’Algérie dans les années 1950 écrit avec sensibilité et lucidité sur son père (Avec tes mains), sa mère (Une étoile aux cheveux noirs), une sœur disparue à quatre ans (À l’ombre du jasmin). Dans le formidable film Alamanya – Bienvenue en Allemagne, une famille turque, installée en Allemagne depuis trois générations, retourne en Anatolie pour les vacances, à la demande du grand-père. Dans le poétique Interdit aux chiens et aux Italiens l’auteur conte les péripéties de ses grands-parents piémontais. Ces témoignages sur le grand-écart quotidien de familles entre deux cultures, de générations aux langues différentes, pétillent d’intelligence et de tendresse. Dans Rock the Casbah, un personnage se trouve à l’intersection des cultures marocaine et américaine et sa famille, ambivalente, lui envie son départ et le lui reproche. Enfin, j’ai écouté une série de podcasts sur la gare de l’Est au rythme apaisant, qui rappelle son rôle pivot dans les immigrations successives depuis la fin du XIXe siècle vers Paris, et hélas les vagues de déportations. Au cœur de Paris, creuset de création, le mélange des cultures s’épanouit, comme les grains de kéfir ou la mama de kombucha s’éveillent grâce à leur rencontre avec l’eau et le sucre. L’ensemble pousse et pétille.

En matière de mélange-miracle de cultures opposées, peu de témoignages éclatent autant que Les mains du miracle, une de mes dernières lectures de Joseph Kessel, émigré à l’échelle de la planète.
Ce récit porte sur un fabuleux docteur, lui-même également fils de la fuite, de la composition entre différentes cultures, et de l’adaptation permanente. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Félix Kersten, médecin spécialisé dans les massages thérapeutiques et réputé auprès des grands d’Europe, se retrouve à traiter Himmler, le puissant chef de la Gestapo, affligé d’intolérables douleurs. Ses massages sont la seule chose qui soulage Himmler qui en fait son médecin personnel. Armé de son humanité, le médecin se lance dans une étonnante lutte d’influence pour arracher des milliers de victimes à l’enfer.
Avant de raconter cet épisode méconnu, Joseph Kessel juge indispensable de préciser, dans le prologue, que tout est vrai. Il a rencontré Félix Kersten, qui l’a traité à l’occasion d’une fatigue sévère, et a donc pu découvrir la relation patient-soignant avec cet homme exceptionnel. Il précise : « Malgré les preuves indiscutables que j’avais eues sous les yeux, il arrivait que je refusais d’accepter certains épisodes du récit. Cela ne pouvait pas être vrai. Cela n’était simplement pas possible. Mon doute ne choquait pas, ne surprenait pas Kersten. Il devait avoir l’habitude… Il sortait simplement, avec un demi-sourire, une lettre, un document, un témoignage, une photocopie. Et il fallait bien admettre cela, comme le reste. »
Le cadre véridique étant établi, le docteur Kresten a raconté avoir pu consulter un document secret d’environ vingt-six pages sur du papier bleu « le plus grand et terrible secret d’État » en possession du secrétaire privé d’Himmler. Dans tout le Reich, seuls deux ou trois pontes en avaient connaissance. Il s’agissait du rapport sur la santé de Hitler.
« Ainsi l’Allemagne et les pays qu’elle avait conquis et la puissance terrible qu’elle représentait encore étaient régis entièrement, souverainement, uniquement, par un syphilitique en pleine évolution, dont le corps et l’esprit subissaient depuis des années les ravages croissants de la paralysie générale. Et par répercussion, le sort des hommes dans le monde entier dépendait d’un cerveau atteint dans sa plus profonde substance.
Depuis juin 1940, où Kersten avait appris que Himmler était chargé de rédiger la Bible du IIIe Reich, le docteur avait le sentiment de vivre parmi les demi-fous. Et ce qu’il avait vu, ensuite, chez les grands chefs nazis, avait confirmé son inquiétude. […] le docteur avait devant lui une étude clinique, une suite d’observations rigoureuses, bref, le fait médical dans toute sa nudité. Il voyait la maladie de Hitler. […] Le roi des fous, au lieu de porter une camisole de force, disposait du sang des peuples pour alimenter les jeux de ses démences. »
Voilà un grand monsieur qui a choisi d’attraper le miracle des deux mains, au péril de sa vie, et qui l’a extrait de force de l’incendie.
Toute ressemblance avec des faits existants est délibérée.
Quand j’étais gamine (et c’est toujours le cas d’ailleurs), je trouvais délirant que personne n’ait évincé Hitler de force dès son apparition. Un type agité, petit et brun aux yeux marron qui prône la supériorité des grands, blonds et aux yeux bleus, c’était évident qu’il était sérieusement déglingué. Et les gens qu’il fascinait malgré cette incohérence fondamentale, aussi.
La Terre et l’humanité sont à nouveau le jouet d’une bande de dangereux détraqués. Nul besoin de subtiliser de dossier top secret, les preuves s’empilent tous les jours dans les médias professionnels. Qui va les mettre au piquet ?
Hé, messieurs dames aux affaires, en voilà une pour vous :
Urgent, à saisir pour cause de sortilège destructeur,
En exclusivité pour ceux dont l’âme dépasse l’ego.
Miracle,
Taille XXL, état neuf.
Allo, y’a quelqu’un ?

J’aime beaucoup ton image de petits miracles qui aident à traverser les jours gris. Les médias de tout genre devraient s’inspirer plus de ceux-ci que des folies incompréhensibles des uns et des autres qui ne font que nourrir le pessimisme. J’avais découvert l’histoire de Félix Kersten à travers une BD historique très intéressante. Merci pour ton partage de lectures 😊
Merci Florence. Je retiens ton idée de la BD sur Felix Kersten que je vais chercher à ma médiathèque.
Plein de bises.