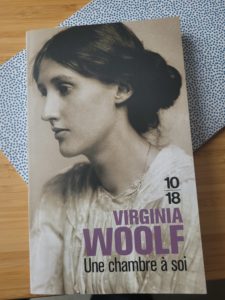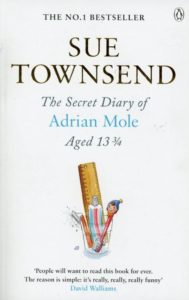Suite de notre périple familial en Italie du Nord



Pigeon vole.
Touriste marche.
Debout dans la rue, à hisser une valise sur les marches d’un pont. Monter, descendre. Venise est tout en escaliers.

Debout dans la gondole au traghetto di Santa Sofia. On a encore raté le marché aux poissons, on s’est trompé de jour. Quand on embarque, le gondolier nous prévient : je ne vais que l’autre côté. Tant mieux, nous aussi.
Debout campo San Barnaba à lécher le cône d’une glace à la pistache qui fond trop vite.
Debout dans un cloître à suivre les pas lents et ordonnés des moines du temps jadis. Ombre, lumière, ombre, lumière. Ombre. Pénombre. Laisser la paix infuser.

Debout au musée dans un palais renaissance, pour mieux jouer à la marelle sur les sols aux marbres polychromes. Debout la tête en l’air pour admirer le plafond. D’autres ont emprunté un miroir encadré de bois sombre pour le contempler, la tête penchée. Il est lourd ce miroir, il m’encombre. Je me tords le cou.
Debout esquichée dans le vaporetto à tenter de glisser grâce aux mouvements de foule à chaque arrêt, vers la rambarde, dans l’espoir de ressentir un souffle d’air.
Debout dans la foule de la place Saint-Marc parce qu’il faut bien y passer une fois, une seule. Serrer son sac à main contre son ventre. Voilà, vous avez vu, on ne reviendra pas. Pas cette fois.

Marcher vers l’avant, vers l’ombre, le détour d’un mur. Se laisser aspirer par la beauté le long de canaux secrets, dans les tréfonds d’une ruelle étroite qui exige presque qu’on avance de profil, comme les Égyptiens des hiéroglyphes. Viens par là, regarde cette plante à la fenêtre, physalis magnifique qui emplit l’ouverture. Comme ce doit être mystérieux à l’intérieur, derrière cette jungle de poupée.

Bifurquer pour s’égarer et semer le touriste, l’Autre, celui que nous refusons d’être, celui qui encombre les rues tout occupé à se prendre en photo devant un décor qu’il ne voit qu’en fond d’écran, derrière son visage au sourire forcé. Celui qui s’agglutine à ses congénères sur les ponts qui donnent sur le Pont des soupirs, haut lieu du circuit obligé vénitien, alors que d’autres ponts, anonymes, ont tellement plus de charme. Passons notre chemin. Allons là où les gondoles à 160 euros de l’heure ne glissent pas. Où l’on n’entend pas le cri du canotier à marinière au coin d’un croisement pour prévenir le canal adjacent qu’il arrive, suivi d’une ribambelle de gondoles, train de parc d’attractions.

Le Grand Canal grouille d’embarcations vaporetto, gondoles, bateaux à moteur de palissandre, aux allures de taxi pour James Bond. Des voix dans toutes les langues s’emmêlent à nos oreilles. Trop de Français, d’Allemands. Je tolère les Américains et les Anglais. Beaucoup d’Italiens, heureusement. Les poubelles débordent. Des bouteilles vides s’accumulent sur des murets. Les papiers gras s’empilent dans les rigoles. Pourtant globalement, la ville est propre malgré son envahissement. Les pigeons n’ont pas droit de cité, des pics se dressent sur les bords des toits. Le touriste lui marche. Interdit de s’asseoir. Ni pique-nique, ni repos sur des marches ou le bord d’un canal. Des affiches et des menaces d’amendes le lui rappellent. Prière de circuler. Les Vénitiens voudraient bien pouvoir vivre. Per favore.
Venise.

Peu d’émotions pour ce troisième séjour. Trop chaud, trop humide, trop de monde. En plus, c’est la fête annuelle de la ville la Festa del Redentore (Fête du Rédempteur). Les journaux titreront que 100 000 personnes ont assisté aux feux d’artifice (sans nous). Une main moite me plaque au sol et m’étouffe. On s’y attendait. C’est pire. Pourtant, notre logement est climatisé. La ville coule sous les pieds du surtourisme. Je suis la surtouriste.
La lumière trop crue efface les reliefs et confisque le charme. Odeur marine de coquillages bouillants. Cris de goélands. Une cigale égarée annonce un pin parasol bienvenu sur une place.
Nous sommes en pleine tempête de chaleur, en alerte météorologique. On ne m’y prendra plus. On voulait faire découvrir Venise aux filles. C’était l’occasion. Tant pis si c’est en plein été. C’est fait. Elles s’extasient heureusement. J’évoque avec nostalgie mon dernier séjour, avec une arrivée par train de nuit dans la brume de la lagune, au petit jour d’un premier janvier.



Ma plus jeune profite de la climatisation de l’appartement, pendant qu’avec sa sœur nous remontons le courant des transhumances à selfie. Cap sur l’ouest, sur l’église Saint-Nicolas des mendiants et sa petite place dominée par le lion de Venise sur une colonne, entre trois canaux, Venise miniature. Vide. On peut glisser une pièce dans l’interrupteur pour éclairer les plafonds et le chœur. Je m’extasie devant les murets d’une chapelle latérale couverts d’un drapé de marbre. Mais comment font les sculpteurs sur pierre ? Le modelage de la terre m’en apprend bien peu sur un matériau impitoyable. Cette église à l’extérieur modeste abritait un temps des femmes en détresse. Je m’en sens proche.
Comment s’habiller ? Shorts et bretelles interdits pour visiter j’église San Pantaléon (désolée, pas pu m’empêcher). Pourtant il fait si chaud.


Fin d’après-midi à la fondation Peggy Guggenheim. Ma grande fille, sous le charme, avide de découvertes, nous suit. Ma benjamine fait l’impasse mais ressortira le soleil couché, pour une glace. Le musée de Peggy est un petit bijou avec vue sur le Grand Canal. Depuis notre dernier passage (avant la naissance des filles), une nouvelle aile a été ajoutée. Qu’aurait pensé Peggy des œuvres sélectionnées ? Une toile blanche lacérée, troisième exemplaire que nous voyons en deux jours. A Vérone elle était rouge. C’est sûr qu’avec un couteau et un stock de toiles on peut assurer une bonne cadence. Le mouvement d’humeur est rentable. Avec la création numérique, la toile lacérée du peintre ou la feuille blanche froissée de l’écrivain a moins de panache. Je n’ai pas daigné lire le nom du fabricant.

Au pied d’un tableau tout en hauteur, simples rayures bayadère (comme une nappe de linge basque), la légende précise « qu’il n’y a rien à comprendre de plus que ce que l’on voit ». Vraiment ? Mon mari et moi le lisons en même temps et éclatons de rire. C’est de l’art moderne ou de l’art contemporain tu crois ? Le snobisme artistique a de beaux jours devant lui. À chaque occurrence, je repense au conte d’Andersen Les habits neufs de l’empereur. Parfois l’empereur est nu et l’artiste, le critique, et le marchand d’art sont des escrocs. Point.
Je passe mon chemin, pour retourner aux œuvres d’art (des vraies) de l’aile d’origine, en tâchant de rester à distance de trois idiots dont hélas je comprends la langue (des Suisses ou des Belges sans doute) qui déblatèrent des inepties à haute voix. Retournez à vos selfies messieurs. Tout ce qui semble facile à faire ne l’est pas.

À la Gallerie dell’accademia, au Palazzo Ca’ Rezzonico, musées fabuleux sur les rives du Grand Canal, je bois les tableaux, sculptures, décorations intérieures de la Renaissance italienne. Je tâche de reconnaitre les saints à leurs attributs, Sainte-Catherine à la roue, Saint-Pierre à sa clef, et guette les détails, l’œillet dans le bouquet de roses, l’oiseau sur la treille, les incohérences rigolotes comme ce Jésus bébé qui tête un sein trop haut, minuscule, qui sort d’une épaule habillée. Les compositions inhabituelles comme la Vierge enfant, ou la Vierge bébé.
Les miens sont fascinés, mais plus pressés.
Parfois me reviennent les paroles d’Aznavour « Que c’est triste Venise le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l’on ne vous tend pas », j’attrape alors la main de mon mari.
Je raconte à mes filles combien je m’étais ennuyée lorsque ma professeur de français de première voulant nous délivrer de « notre ignorance crasse », nous avait emmenés voir Mort à Venise de Visconti d’après le roman de Thomas Mann.

Les questions m’assaillent, comme à chaque visite d’un lieu difficilement accessible. Comment est arrivé ce qui est dans mon assiette ? Où partent les eaux usées ? Où passent les tuyaux d’eau propre ? Comment et où jeter ses déchets ? Oui, hein ? Fais voir le dépliant… Détritus à poser dans la barge sur le canal San Barnaba, avant 8 h 30. Ce qui se traduit par un « pas ce matin chéri, on a poubelle. »
La responsabilité de l’évacuation de ses déchets encourage à les réduire au maximum.

Heureusement le lever tôt permet de se mêler aux Vénitiens, les vrais, ceux qui habillés de frais et de chic (comment font-ils par cette touffeur ?), marchent vers leur arrêt de vaporetto et leur journée de travail, ceux qui gobent, debout, dans une pâtisserie un caffè ristretto et une viennoiserie. Comme eux, nous prenons notre petit-déjeuner à la pasticceria Majer de San Margherita, accoudés à leur comptoir extérieur. Debout.

Privilège de touristes, nous sommes habillés confortablement et chaussés de baskets, et prenons le temps d’un deuxième café, d’un deuxième croissant (aux amandes, délicieux, après celui à la pistache). Avant de commander les focaccias pour le pique-nique que nous mangerons sous un pin, sur un banc, sur l’île bucolique de Mazzorbo. Assis.

À cet arrêt, nous étions les seuls à descendre du vaporetto bondé, où je manquais de suffoquer tout en ventilant ma fille avec mon chapeau. Bloqués par la foule, nous ne pouvions atteindre la sortie. Le bateau a failli repartir sans nous poser. Le monstre à cent têtes, monté à Murano (que nous avons évitée) est descendu à Burano se prendre en photo devant les maisons de toutes les couleurs. Pauvres habitants, contraints de subir, comme Disneyland, les assauts quotidiens de leur gagne-pain. (Nous aussi nous prendrons des photos de Burano, et passerons de longues minutes chez un artisan verrier pour choisir des boucles d’oreilles).
Trempage de tête sous une fontaine. Oh zut on a oublié de se connecter pour tenter d’acheter les billets du concert de Taylor Swift. Cette dame que je ne connaissais pas il y a un mois, s’est invitée pour nos vacances. Tout ça parce qu’une collègue de mon mari a cru bon de rappeler aux parents d’adolescentes qu’elle passait en concert à Lyon l’an prochain. Mes filles se sont découvert une soudaine passion. La rareté reste un outil marketing redoutable.

Fin du séjour. Allez, on fait les valises les demoiselles.
On emballe le classeur grand format à fleurs déniché à Vicenza, le ukulélé transporté pour le plaisir, le pot de menthe parce que nous n’avons pas eu le temps de le cuisiner. Deux grands cabas de courses alimentaires se sont ajoutés aux bagages. Comment est-ce qu’on se débrouille à chaque fois ? C’est ignoble de transporter de la nourriture. Surtout en train. Cette fois, j’ai tiré le trait sur les trois bananes brunissant.
Dans la gare, en attendant le train pour Milan pour rejoindre Gênes, nous mangerons nos focaccias du jour et les tartes au riz (risini). Eux assis, moi debout.
À bientôt Venise aux si belles couleurs décaties, aux détails charmants à chaque coin de ruelle. Nous reviendrons c’est promis.
À la lumière de l’hiver.
Souvenirs d’autres lieux-sourires