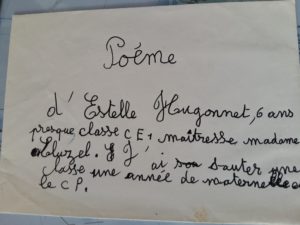Quand les couleurs se fâchent tout vert, moi aussi.



Hier le peintre me l’a promis, cette fin de semaine la rénovation du garage, « c’est sûr à 100 % ce sera fini ». Je ne demande qu’à le croire, j’ai hâte de quitter ma chambre aux murs troués pour un espace définitif, où mes vêtements ne prendront plus la poussière, où je retrouverai des tenues autres que des jeans, et où mon piano pourra renaître de son nid de couvertures et de plastique. C’est la troisième fois en trois semaines que des impondérables ont raison de son engagement. Le dernier décalage, hélas, est dû à cause d’une accumulation de vert.
Si vous n’êtes pas allergiques à la poussière, entrez donc visiter.
Pour le couloir, la salle de bains et les toilettes, nous avons choisi un sol en imitation de carreaux de ciment. Les motifs permettent d’ignorer les cheveux qui trainent, le côté désuet âge joliment la maison, le ton brique évoque la terre cuite, toutes illusions optiques favorables à mon bien-être personnel. Sous peine de chuter dans un effet stroboscopique désastreux, les trois teintes et le décor obligent cependant à une austérité décorative.
La couleur des murs se devait donc d’être sélectionnée avec attention. Le peintre nous a confié un nuancier aux mille deux cent trente six variantes, dont nous avons consulté l’éventail sous toutes les lumières, à toutes les heures, dans chaque pièce concernée, et surtout, surtout, au voisinage dangereux du carrelage.
Notre choix s’est porté sur un gris très pâle, aux discrètes nuances de rose, afin de rendre le « blanc » plus intéressant. Cette teinte doit couvrir tous les murs de l’ancien espace garage, à part un recoin brique dans les toilettes et un panneau marron glacé dans la chambre. L’enjeu est donc de taille. La veille de la commande de la peinture, nous avons présenté notre décision aux artisans, à genoux, dans le couloir carrelé, sous le plafond nouvellement mis en lumière.

-Regardez ça va bien aller non ? Avec le rouge, avec le gris…
-Hmm… Oui…
-Oui… mais ?
-Mais ce sera froid, il vaudrait mieux une couleur plus chaude.
Nous explorons ensemble l’éventail.
-Ça. Ça, c’est pas mal. C’est doux et plus chaud, plus lumineux.
-Tiens oui, c’est une bonne idée ça.
Mon mari et moi étudions le rectangle de quatre centimètres carrés, et le présentons à la lumière sous toutes les inclinaisons.
-Oui, partons sur ça. Ouf. On a failli se tromper. Quelle catastrophe ça aurait été ! T’imagine, si en entrant dans la salle de bains on avait grelotté !
Mon soulagement est palpable. Je préviens le peintre – carreleur :
-Je vais vous refaire le mail ce soir pour les références de couleurs.
Le lendemain, je m’assure qu’aucune confusion n’est possible :
-Vous avez bien reçu le mail ? J’ai mis « annule et remplace », en majuscules, hein. L’autre vous n’en tenez pas compte.
Pas de bourde s’il vous plait, qu’on ne se retrouve pas coincés entre des murs inconfortables !
Jeudi dernier, mon mari et moi étions tous les deux absents pour la journée. Cela arrive rarement ; notre présence constante est épuisante, mais doublement rassurante : nous pouvons à la fois suivre les travaux en temps réel (et retenir la truelle du maçon à la dernière minute) et contenir Gaïa en haut des escaliers grâce à une barrière composée d’un pouf de canapé basculé sur la tranche et d’un panier à linge, le tout crénelé de deux chaises couchées en travers. Je m’attends chaque jour à basculer d’un étage la tête la première.
Jeudi dernier donc, après un déjeuner fort agréable dans le café d’une copine (Équilibres), j’ai marché jusqu’à mon atelier de poterie. Un soleil printanier remplissait les terrasses des restaurants et celles des quais du Rhône. J’avais laissé passer l’heure de départ et suis arrivée à la bourre à mon cours. Vite poser la veste, le sac, sortir les lunettes et le tablier. Pendant que je le nouais autour de la taille, l’artiste-animatrice m’a dit :
-Tu as vu ton arbre ? Il a coulé.
-Quoi ? Mon arbre ? Il a coulé ?

En deux pas, le repérer sur les étagères où sont présentées les pièces terminées après la cuisson, l’attraper et dans un même élan, être réconfortée par sa forme et son toucher lissé par l’émail transparent, et dévastée par son aspect.
Mon arbre à la petite fille perchée, mon arbre ravissant avant que je ne le gâche avec des couleurs est défiguré. J’hésite toujours à ne pas laisser mes pièces brutes, ou à peine patinées de cire ou de peintures très diluées. La sorcellerie de la céramique est redoutable : du feu, de la terre et des teintes sous forme d’émaux, d’oxydes ou d’engobes (terres colorées). Le résultat à l’ouverture du four est en général une surprise. Parfois un désastre.

L’oxyde de cuivre du chemisier et des chaussures de ma demoiselle a migré : dans le four à mille degrés il s’est envolé et redéposé sur les cheveux, les mains, la peau, le tronc de l’arbre.
-Mais ça va aller. Tu vas le frotter avec de l’encre de Chine. Ça va faire ressortir les craquelures et ça ne se verra plus.
-Vraiment ?
Je l’ai fait sans y croire. Je le vois toujours, ce vert amer.
Ma sculpture emballée dans de vieux exemplaires du Progrès et l’ai rapportée à la maison en bus, trésor abimé sur les genoux, attentive à ne pas le choquer. Je me forcerai à lui trouver une vision poétique « l’enfant dans un arbre nu lui transmet le vert de la vie ». C’est plus joli que « bigre, le T-shirt a déteint ». J’ai décidé de l’aimer encore plus malgré ses imperfections ou grâce à elles, comme le kitsugi, ces réparations à la colle dorée qui magnifient les céramiques japonaises.
À peine arrivée dans ma demeure du chaos, on m’appelle depuis le tréfonds de ce que j’appelle encore le garage.
-Viens voir, viens, voir. On a avancé la peinture.

Je pose mon arbre sur l’escalier avec la douceur autorisée par mes mains impatientes, et fonce découvrir mes murs. Couloir, virage (écrit comme cela on dirait que c’est immense), devant les portes de l’atelier et de la chambre je m’arrête, interdite. Mes épaules se hissent, mes mâchoires se serrent, mes ongles griffent un tableau plus vert que noir imaginaire. Du papier aluminium crisse entre mes dents. Le voisinage avec la couleur du mur du fond est abrupt : la chambre hurle. L’atelier crie.
Les murs sont jaune-vert.
Ni beaux, ni chaleureux, ni vraiment lumineux, car le vert refroidit et ternit le jaune.
Le peintre attend muet ma réaction.
-Heu…
Je ne veux pas d’emblée dénigrer son travail. Je fais le tour des deux pièces, plusieurs fois, en m’imaginant venir me coucher là ou m’assoir à une table pour travailler la terre et y modeler un arbre qui, avec un peu de chance, ne virera pas à la deuxième cuisson. Non, non ce n’est pas possible. On dirait que la pelouse étoilée de primevères sauvages d’un jaune beurre a coulé à l’intérieur. Je grimace.

-C’est jaune. C’est même jaune-vert.
-Oui c’est jaune-vert.
-Ce n’est pas du tout possible pour les pièces avec le carrelage rouge.
Ni pour les pièces déjà peintes.
Aïe, aïe, aïe.
Vert colère, tapi, invisible, dans le minuscule échantillon.
Si seulement j’avais descendu le café après la couverture du premier panneau. Si seulement le peintre nous avait alertés. Branle-bas de combat. Retour à l’éventail du nuancier. Sélection d’une teinte proche de notre choix initial. Peinture d’échantillons in situ. Comment décider d’une teinte de vie sur quatre centimètres carrés ?
Soulagement. Le deuxième choix est le bon. Les murs agressifs se sont adoucis. Je peux m’imaginer y dormir et y créer. On ne frissonne pas en entrant dans la salle de bains.

Deux jours plus tard à Paris, je racontais cette anecdote à une amie de Mainz. Dans l’après-midi, alors que nous longions une boutique d’objets de décoration, je lui indique une vitrine :
-Regarde c’est ce vert que je voudrais mettre sur le mur de la cuisine.
-Ah bon ? Je croyais que tu n’aimais pas le vert sur les murs…
Sourires.
C’est vrai. La prudence est de mise. Les erreurs sont possibles, privilégier les échantillons et un tempo andante pour éviter les déconvenues.
Un peu plus loin, nous passons devant un pub irlandais bariolé de fanions orange et vert, et dont les clients débordent sur le trottoir. Ah, oui, regarde, demain c’est la saint-Patrick. Quand mes filles étaient en maternelle et primaire, l’école organisait une journée verte. Elles fouillaient dans leurs placards pour s’habiller couleur Irlande le 17 mars.

Printemps
Prin-tant pis
Prin-tempête
Prin-tambour battant
Le printemps affleure, dehors, dedans, et notre vie se pare de vert.
Ce matin, je baisse les yeux sur mes mains qui courent sur le clavier, elles sortent d’un chemisier vert à pois blancs. Elle l’affirme, toutes les nuances de vert fleurissent cette saison sur les palettes de maquillage, tilleul, granny-smith, sapin, prairie.
Nous espérons échapper aux éclats de verre (oui le jeu de mots est facile, pardon).
Hier les électriciens étaient là, l’artisan et son apprenti me saluent d’un « bonjour madame » très poli. Je leur réponds, à l’un « Bonjour » et à l’autre « Bonjour Kévin ». J’ai laissé échapper un matin par mimétisme un bonjour, monsieur, mais à un tout jeune adulte ça a sonné très faux. Ils s’égaillent l’un sur le toit de l’extension à faire des trous dans ce que je j’espère être le mur et non la couche d’étanchéité toute neuve, et l’autre entre notre chambre et notre salon.
Et c’est parti pour la chorale d’invectives, le toit crie à la chambre :
-Mais pu***n Kilian, qu’est-ce tu f*** ?
Mince alors.
En allant chercher un livre, je croiserai l’artisan dans notre chambre actuelle découpée selon les pointillés. Il l’a « rangée » pour pouvoir faire de nouveaux trous dans le plafond. Les tables de nuit et leurs contenants sont échoués sur le lit : livres, lampes, crèmes, chaussettes, tablette… Ouf, les lunettes ne sont pas cassées.
Il glisse un câble par la fenêtre entrouverte.
-La fenêtre est tombée tout à l’heure. Je l’ai raccrochée, mais faites attention. Ça ne tient pas beaucoup.
Elle est raccrochée avec un clou dans un bout de Placoplâtre grand comme ma main au-dessus d’un canyon de vide.
Ne pas éternuer à proximité sous peine, avant de la mettre sur Le bon coin, d’obtenir la réponse, à la question fondamentale : combien pèse une fenêtre en double vitrage, ouvrant droit, intérieur blanc, extérieur gris ?
Alors ? Une petite idée ?
Tout dépend sur combien d’orteils elle atterrit.
Tout va bien.